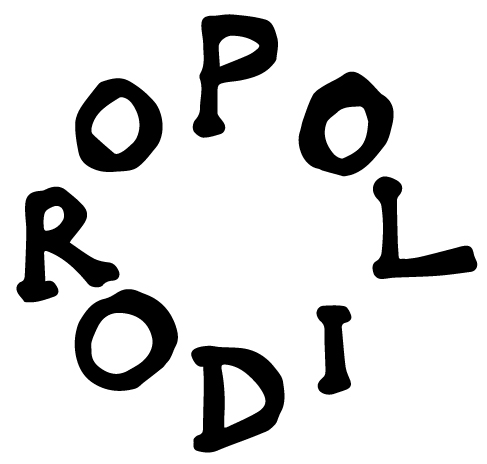DES ÉPIPHANIES DANS LE SILENCE DES IMAGES
Le rêve et la tâche ardue de la critique d’art sont de saisir le mouvement de la pensée des artistes, la lueur de leurs processus de réflexion, les nœuds intellectuels qui les fascinent et les obsèdent tout au long de leur existence. Sans aucun doute, l’“idée fixe” de Julie Polidoro – comme elle-même me l’a avoué il y a quelque temps – est une question fondamentale pour tous les arts: comment traduire l’espace. C’est autour de cette idée que se développe l’ensemble de sa pratique artistique, et donc également cette exposition. Voyons comment.
Tout d’abord, il est nécessaire de préciser que l’espace “traduit” par Polidoro est l’espace du monde géométriquement réduit à une surface plane, à une image, à un simple objet de représentation. Un monde qui – comme l’a précisé Giacomo Marramao dans le domaine philosophique – a cessé «d’être l’habitat dans lequel nos vies sont immergées, la dimension qui entoure et implique les destins de nos existences humaines dans un entrelacement inextricable avec d’autres formes de vie et des existences non humaines, pour devenir un objet de connaissance qui peut être rationalisé, mesuré, calculé et, par conséquent, soumis et modelé par les dispositifs de représentation […] visant de manière productive à dominer l’objet-monde, mis en place par le sujet ».
Mais la question de l’espace est étroitement liée à celle du temps, car à l’espace homogène et unitaire correspond le temps vide et homogène du capital, qui inscrit tout événement dans une hiérarchie chronologique implacable et figée ; un temps utopique, puisqu’il ne se situe en aucun point de l’espace réel. Le monde “traduit” par Julie Polidoro est alors un monde où – pour citer à nouveau Marramao – «l’expérience ne se donne que par les événements muets – sans parole ni valeur, et pourtant mesurables et sujets aux lois – qui ont lieu dans la dimension, en dernière instance physique, de la facticité naturelle». Un monde, donc, où l’expérience ne peut pas se donner dans les événements symboliques et émotifs du vécu, parce que aucun lieu ne se donne par eux. Ce n’est pas un hasard si les “sujets” choisis par Julie Polidoro dans cette exposition sont des sujets éminemment “muets”.
D’un côté, les corps des migrants qui gisent abandonnés sur les sols nus des prétendus centres d’accueil. “Non-personnes”, selon la définition d’Alessandro Dal Lago: des corps sans nom ni visage, réduits au statut d’objets et “stationnés”, tels des colis dans une grande chaîne de distribution, dans des “abris” temporaires, en attente de retrouver leur vie. Les frontières, les centres de détention pour les personnes migrantes et les espaces de ségrégation sont en réalité des “états d’exception” où se matérialisent les effets de cette spatialisation appauvrissante, déshumanisante et mortifère qu’Achille Mbembe a nommée “nécropolitique”. Ce sont des “zones de mort sociale” qui produisent des individus hors-la-loi, ramenés à ce que Giorgio Agamben, reprenant le droit romain, a appelé “vie nue”: une vie radicalement dépolitisée qui n’est incluse dans l’ordre juridique que sous la forme de son exclusion. Une vie exposée de manière absolue au pouvoir souverain de l’Autre et qui, en tant que telle, n’est pas sacrifiable, mais simplement tuable. Par conséquent, le sujet qui en est porteur est, déjà, d’une certaine manière, mort.
De l’autre côté, dans l’exposition, se trouve une série de paysages représentant des tempêtes de sable imminentes, qui ne sont rien d’autre que les effets de ce qui est généralement et euphémiquement appelé “changement climatique” et qui devrait plus précisément être appelé “réchauffement climatique”. Oui, c’est la pollution produite par notre espèce qui entraîne le réchauffement climatique, l’“hyperobjet” par excellence selon Timothy Morton, l’autre grand “thème” choisi par Polidoro; ce même réchauffement qui est directement responsable de l’intensification des dommages causés par les ouragans ces dernières années. Ce thème, qui peut sembler éloigné de celui des migrants, est en réalité étroitement lié à lui pour deux raisons principales. Tout d’abord, comme cela a été largement démontré, dans un avenir proche, le réchauffement climatique sera à l’origine de migrations massives, destinées à provoquer une augmentation des tensions sociales et géopolitiques. Ensuite, les images des migrants ainsi que celles représentant les tempêtes de sable utilisées par Polidoro comme modèles pour ses œuvres sont des images qui proviennent du Web. Voilà qui dessine plus clairement le caractère muet de ces images: les deux sont des images de “catastrophes” qui, cependant, dans leur consommation numérique, ne sont pas perçues comme telles. On pourrait dire qu’elles sont des images d’un Réel traumatique qui a nécessairement été domestiqué afin d’être rendu consommable. En somme, ce sont des images dé-facticisantes, qui nous protègent de la réalité “sale” et “dérangeante”, insupportable à regarder. Ce sont des images qui nous bombardent quotidiennement, mais qui, précisément parce qu’elles ont perdu leur “violence”, ne se fixent de manière dramatique ni se sédimentent dans notre mémoire. En effet, aussi absurde que cela puisse paraître, les caractéristiques communes de ces images-symboles ne sont certainement pas l’émotion ou l’indignation qu’elles suscitent, mais leur iconicité et la viralité que celle-ci comporte.
Et alors, le travail de traduction de Polidoro devient clair: un travail qui vise à faire émerger dans l’œuvre la perception de cette “différence” irréductible, cet écart qui persiste entre l’événement réellement vécu – terrifiant, dramatique, potentiellement fatal, indicible – auquel ces images renvoient, et sa représentation, consommable et virale, vécue sur le Web. Un travail qui vise, en d’autres termes, à récupérer ce “non vu” – comme l’indique le titre d’une œuvre exposée – présent dans le silence assourdissant de ce qui est visible. Julie Polidoro y parvient en inventant de nouvelles façons de cartographier l’espace et le temps. Son travail me paraît une véritable “critique de la raison cartographique” (Farinelli), c’est-à-dire de la cartographie qui objective et sectionne le monde. Consciente du fait que les géographies façonnent les processus et les actions sociales elles-mêmes, Polidoro oppose à une “lisibilité du monde” (Blumenberg), où la domination de la représentation se résout en injonction à découper le monde et à l’aplanir, des “nouvelles” cartographies qui correspondent à des “nouvelles” logiques, à des “nouvelles” façons de penser le monde autrement. Et c’est précisément cela, à mon sens, qui rend sa peinture extrêmement actuelle.
Si les images du monde véhiculées par les dispositifs de représentation sont des images “saturées”, uniformes, dont la seule fonction est la transmission et la propagation d’informations, Polidoro crée des images “insaturées”, incomplètes, instables, des images où il y a des “vides”. Ces images servent ainsi de contre-information, de contre-récit, de véritable acte de résistance. En laissant des espaces vides qui révèlent le support “vierge” ou en peignant sur des morceaux de ruban adhésif qu’elle déplace ensuite à l’intérieur de l’œuvre, Polidoro crée des trous au sein des images. L’objectif est de soustraire ou de déplacer des informations afin de perturber la syntaxe et de laisser ainsi à l’observateur un espace de mouvement et de réflexion. En interrompant – à travers des débris et des déplacements métonymiques qui agissent comme des éléments perturbateurs et déroutants – la lecture linéaire, rapide et dématérialisante propre à la visualisation sur le Web, elle contraint le spectateur à capturer d’autres perspectives: à prendre en considération, à l’intérieur de l’image, d’autres points de vue possibles, ces points de vue qui sont généralement réduits au silence et exclus, et qui, au contraire, empêchent la fermeture parfaite de la représentation.
En perforant l’image, Julie Polidoro nous oblige en somme à reconnaître la singularité de ce qui est caché dans notre subconscient automatique, l’autre scène sous-jacente à la structure de notre présent, cette “prose du monde” – faite non d’un espace-temps uniforme, mais de lieux singuliers, qualitativement connotés, de temporalités radicalement hétérogènes, asynchrones et dissonantes, d’expériences submergées, de densités différentes et sans synthèse, de dynamiques relationnelles – qui constitue le facteur constitutif de notre action et de notre concret, corporel être-au-monde.
Giuseppe Armogida
Giuseppe Armogida is a philosopher and independent curator.
Currently he teaches Aesthetics and Phenomenology of the Image at the Accademia di Belle Arti L’Aquila and Semiotics of Art at NABA in Rome.